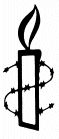Haïti aujourd’hui. ( Années 1990-
2004)
Il existe quelques pays dans le monde où la faim est dramatiquement
omniprésente à l’échelle du pays tout entier: Haïti
en fait désormais malheureusement partie. La malnutrition avec tous
les autres problèmes associés de la misère y fait des
ravages, le pays se retrouve, avec l’Erythrée, l’Ethiopie,
la Guinée Bissau, la Somalie et quelques autres pays en guerre, parmi
les plus pauvres de la planète.
Aujourd’hui, l’instabilité et la violence s’ajoutent à la
misère : les oppositions au régime sont de plus en plus radicales
et nombreuses, le régime semble s’être transformé en
dictature, qui certes n’a rien de comparable avec certaines de celles
qui l’on précédée, mais qui cependant représente
une immense déception parmi tous ces gens qui n’ont plus rien
et qui avaient mis en ce régime tous leurs espoirs. On trouve aujourd’hui, à Haïti,
des gens du peuple pour regretter l’époque des Duvaliers, « car,
disent-ils, nos enfants ne mouraient pas de faim ». Comment a-t-on fait
pour en arriver là ?
Les années Aristide ( Né en 1953 à Port Salut)
1990-
2004
Que se passe-t-il depuis l’année 1990, année où Aristide
prend le pouvoir, après une énième sanglante dictature,
celle du Général Avril, ( 1998-2000) deux ans après que « Baby
Doc » le fils Duvalier se soit enfui du pays après une dictature
de 15 années ? (Durant ces années, jamais l’aide internationale
ne fut si importante, avec son lot de détournements et de corruption.)
 1990
Election de l’ancien prêtre catholique des Bidonvilles :
Jean Bertrand Aristide.
1990
Election de l’ancien prêtre catholique des Bidonvilles :
Jean Bertrand Aristide.
67% des voix ! C’était la première élection démocratique
du pays ; l’élection fut libre et, en gros, équitable.
La victoire dans son ampleur n’eut d’égal que l’espoir
suscité par l’accession au pouvoir de cet homme, adulé du
petit peuple, et qui était déjà une légende. Le
parti d’Aristide s’appelle « Lavalas » (l’Avalanche
en créole).
Cela faisait presque deux siècles que le peuple Haïtien subissait
des dictatures et des régimes sanglants, après trois siècles
d’esclavage. Ce fut donc un immense enthousiasme dans les premiers mois
et Aristide promit beaucoup, et bien sûr d’abord que les pauvres
sortiraient de la misère. En résumé, l’égalité des
chances, la scolarité pour tous, du travail, la justice, la liberté…la
dignité. On Nettoya Port au Prince de fond en comble, on se préparé à un
avenir meilleur…C’était beaucoup pour ce petit peuple stratégiquement
placé au cœur des Amériques, même s’il n’y
avait vraiment plus grand chose à piller. (Bush père est au pouvoir
chez le grand voisin…qui laisse faire, tout en ayant un regard vigilant)
 1991
Coup d’Etat. Les militaires au pouvoir.
1991
Coup d’Etat. Les militaires au pouvoir.
Dix huit mois après son élection, Aristide est renversé par
les militaires. Trois ans d’une nouvelle violence dont le monde parlera
peu. Mais les Haïtiens en ont tellement vu ! Le Général
Raoul Cedras s’empare du pouvoir. Aristide s’exile aux USA. Le
premier président élu de l’histoire haïtienne n’a
pas eu le temps de transformer Haïti, et en particulier de mener à bien
sa campagne contre la corruption et de terminer le renouvellement de l’armée,
qui était corrompue, se livrait à tous les trafics et crimes
auxquels l’avaient habituée tant d’années de dictature,
ayant plus souvent tiré sur le peuple que sur d’éventuels
ennemis extérieurs.
 1994.
Bill Clinton envoie à Haïti des troupes qui remettent Aristide
au pouvoir.
1994.
Bill Clinton envoie à Haïti des troupes qui remettent Aristide
au pouvoir.
Un vaste réseau de gouvernements étranger et d’institutions
financières internationales propose à cette époque leur
aide pour reconstruire le pays. Mais elles demandent en retour « des
ajustements économiques structurels », ce qui signifie des privatisations,
le respect des exigences du FMI, dont on sait qu’elles ont ruiné bien
autres pays autrement plus solides qu’Haïti. Le pays exsangue est
dépendant des résultats obtenus pour que les aides soient débloquées.
Or ce sont les aides qui sont à la base des changements du pays.
L’opposition « Convergence Démocratique » s’organise
et poursuit un but : chasser Aristide du pourvoir. Crédits coupés,
armée peu fiable, opposition prête à tout pour reprendre
le pouvoir, Aristide ne peut mener à bien aucune des réformes
prévues et le pays s’enfonce dans la misère et peu à peu
dans la violence.
 1996.
l’Intermède René Préval.
1996.
l’Intermède René Préval.
Selon la constitution haïtienne, Aristide, arrivé à la
fin de son mandat, n’a pas le droit de se représenter. Il appuie
alors la candidature d’un homme à lui : René Préval.
Pour la première fois de son histoire, Haïti verra deux présidents élus
démocratiquement se succéder. Mais les dissensions internes paralysent
les gouvernements. Préval a passé plus de temps à essayer
de rester au pouvoir qu’à gouverner le pays. L’aide internationale
est bloquée, la raison invoquée est l’instabilité politique.
Certes, elle est flagrante, mais c’est le petit peuple, une fois de plus,
qui en fait les frais.
 2000.
Aristide se présente de nouveau à l’élection
présidentielle. 98% des suffrages !...
2000.
Aristide se présente de nouveau à l’élection
présidentielle. 98% des suffrages !...
De tels scores ne trompent personne. Certes, l’opposition a boycotté les
urnes. Mais les élection législatives du mois de mai ont eu lieu
sans vrai contrôle (les Etats Unis ayant refusé de contrôler
ou de d’appuyer ce scrutin). Aristide remporte cette élection
avec une marge considérable sur ses adversaires. Mais ce scrutin est
contesté, on accuse le parti Fanmi Lavalas (un parti constitué des
fidèles d’Aristide, après les événements
du 19 août 99 où le palais présidentiel fut attaqué)
de fraude, d’intimidation, de violence. L’opposition haïtienne
ne reconnaîtra pas cette élection. Pas plus que la communauté internationale.
La sécurité n’existe pas plus que la justice dans le pays.
La corruption sévit plus que jamais. Les Etats Unis retirent leur aide à la
police et au système judiciaire du pays. L’OEA (Organisation des
Etats Américains) hésite à aider ce pays imprévisible.
Tout en disant vouloir aider la démocratie à se mettre en place,
en aidant un groupement de partis d’opposition, la Convergence, qu’ils
ont financé et conseillé, les USA sapent le régime d’Aristide
qui se radicalise dans les faits, tout en l’acceptant officiellement
comme représentant la nation jusqu’à la fin d son mandat.
L’embargo financier affame le pays. (La BID, Banque Internationale de
Développement, n’a débloqué aucun des crédits
promis). Faute d’argent, rien ne fonctionne désormais dans le
pays.
2000 – 2004 Les aides au compte goutte. La souffrance d’un peuple.
C’est l’Agence Américaine pour le Développement
International (USAID) qui distribue à quelques ONG importantes ces miettes
qui tâchent d’éviter ici et là la famine, sans résultat
car la misère s’étend aujourd’hui aux couches moyennes
de la société. 85% des habitants vivent de manière précaire
de petits boulots qui permettent à peine de nourrir leur famille. Certes,
il est nécessaire de mettre de l’ordre, mais comment collecter
des impôts parmi une population en totale détresse, qui ne parvient
pas à se nourrir ? Le pays fourmille d’ONG chacune oeuvrant dans
son coin de misère.
Les gens vous diront souvent qu’aujourd’hui Aristide est un homme
riche, attaché à son pouvoir, et qui a tout oublié de
ses idéaux et des promesses de celui que le peuple appelait familièrement
et affectueusement « Titid ». C’est peut-être vrai.
La propagande, ici et là, le peint soit comme une victime de cabales
internationales, soit comme un apprenti dictateur à la tête de
milices sanguinaires. Rien n’est tout à fait vrai. Il existe cependant
incontestablement des exactions qui sont le fait du parti Lavalas : soit utilisées
volontairement pour installer la peur, soit que le pouvoir en place ne contrôle
plus les bandes armées (on les appelle les Chimères), recrutées
pour la plupart dans les bidonvilles, zones de non droit où les armes
s’accumulent, le trafic de drogue est florissant, et parmi lesquelles
d’anciens miliciens d’autres régimes ont fait leur place… Les
O.P. (Organisations Populaires) qui étaient à l’origine
des comités destinés à enraciner la démocratie
dans le pays, ou à en faire connaître les pratiques quotidiennes
(si Haïti a vécu quelques années sous des régimes
officiellement démocratiques, elle n’en a jamais connu la pratique
tant les présidents sont vite devenus des dictateurs…) sont devenus
des gangs armés défendant avec des pratiques identiques à celles
des années de plomb des Duvalier, ce qui reste du régime.
A l’évidence, Aristide veut garder le pouvoir. Il estime qu’il
devrait obtenir une dérogation à la constitution, ses trois années
d’exil se transformant en trois nouvelles années de pouvoir. Ce
que les Américains lui refusent…et quand l’Amérique
refuse… Tous les moyens semblent désormais mis en œuvre pour
se débarrasser d’Aristide. Il essaie de détourner l’attention
(pratique vieille comme le monde…du pouvoir) avec cette histoire de restitution
de la dette… 21 milliards de dollars qu’il réclame à la
France en place des 90 millions de francs or que le pays avait payé à la
France en dédommagement des expropriations des colons esclavagistes,
après l’indépendance.
Le monde entier devrait aider Haïti. Mais que font les pays du monde
?
Ils regardent – et chacun commente, désabusé, le naufrage
- ce petit pays s’enfoncer dans la nuit de la misère. Que deviennent
les droits de l’homme ? Le sida y fait plus de ravages que n’importe
où dans le monde. Les enfants ont faim et toute leur vie ils porteront
les stigmates de cette sous nutrition. L’école ne peut plus jouer
son rôle, qui était déjà très mince (85%
d’illettrés). La santé des habitants se détériore
et l’espérance de vie ne guère dépasser les 50 ans.
Le pays est une plaque tournante de la drogue avec son cortège de violence.
La violence s’aggrave, générée par la misère
d’une part, d’autre part par la radicalisation des conflits entre
le régime et l’opposition. Des troubles sanglants éclatent
journellement dans le pays, les manifestations dégénèrent.
Qui commet les crimes, dont les victimes sont aussi bien des journalistes,
des hommes politiques que des citoyens ordinaires qui passaient ou des caïds
du milieu (…un mort par jour retrouvé dans les rues de Port au
Prince…) ? Les mafias ? Les Chimères pro ou antigouvernementales
la PNH (Police Nationale Haïtienne) ? Créée avec l’aide
de l’ONU entre 94 et 95) D’autres groupes inféodés à tel
ou tel parti ? Personne ne sait vraiment. Il vaut mieux ne pas savoir. On assiste
tout de même à l’apparition de « Brigades spéciales » et
de groupes de civils armés dont la réputation n’a rien à envier
aux Tontons Macoutes des années duvaliéristes les plus noires.
Les zones de non droit comme Cité Soleil où sévissent
les « Chimères », ce sont des bandes lourdement armées,
trafiquants tous azimuts, dont certains sont liées au pouvoir, et qui
pillent violent et tuent, si bien que les ONG sont contraintes de quitter certains
quartiers.
La fuite des Ministres s’accentue…Aristide se retrouve de plus
en plus seul. Les habitants tentent de fuir le pays vers Saint Domingue, d’autres îles
des Caraïbes ou les USA ou les « Boat People » font des victimes
de la mer et de la misère.
Il est terrible que la communauté internationale, toute à ses
calculs et ses réflexion, paralysée par les normes aveugles,
inhumaines, des institutions financières internationales, et ses propres
intérêts financiers ou politiques, si prompte à s’émouvoir,
soit si longue à ouvrir les yeux sur ces drames humains. Personne ne
peut actuellement se dédouaner d’une part de responsabilité dans
ce qui est en train de devenir une catastrophe humaine. Et pourtant, le peuple
haïtien est un peuple admirable et qui se bat, en dépit de toutes
les raisons de désespérer de soi-même et du reste du monde.
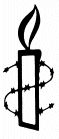
|
Amnesty International
Haïti
Les droits humains depuis le coup d'État : une décennie d'avancées
et de reculs |
Résumé *
Dans la nuit du 29 au 30 septembre 1991, un violent coup d'État renversait
le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide, formé seulement sept mois
plus tôt. Haïti a alors connu trois années de répression
et de violences meurtrières, dont les membres du mouvement Lavalas ,
partisans du président Aristide, ont été les principales
victimes. Avec le retour à l'ordre constitutionnel, en octobre 1994,
les espoirs d'une amélioration de la situation des droits humains en
Haïti ont été ravivés.
Dans les années qui ont suivi, des progrès importants ont été accomplis :
l'armée a été démantelée, le réseau
des « chefs de section » (chefs de la police
locale qui faisaient la loi dans les campagnes) a été dissous
et une force de police a été créée pour les remplacer.
La liberté d'expression et d'association s'est considérablement
développée. Cependant, le lourd héritage du passé – par
exemple, les dysfonctionnements qui affectent le système judiciaire – continue à se
faire sentir. À cet obstacle s'ajoutent des difficultés nouvelles
qui remettent en cause les progrès déjà accomplis.
Pour leur part, les membres du mouvement Lavalas qui occupent presque
tous les postes officiels sont aujourd'hui impliqués dans le retour à des
pratiques dont ils ont eux-mêmes été victimes à l'époque
du coup d'État. Les tentatives faites pour réprimer la liberté d'expression,
les pressions politiques qui s'exercent sur la police et l'appareil judiciaire
ainsi que l'incapacité des membres de ces institutions à protéger
les droits humains sont des motifs croissants de préoccupation. Les
violations des droits humains aujourd'hui en Haïti sont moins dramatiques
qu'elles ne l'étaient dans les années qui ont suivi le coup d'État,
mais si la tendance actuelle, qui est très préoccupante, n'est
pas renversée, le pays risque de connaître des violations de plus
en plus graves des droits fondamentaux.
Télécharger le document complet  (273
ko)
(273
ko)
* La version originale en langue anglaise
du document résumé ici a été publiée par
Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres
WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre : HAITI. Steps Forward, Steps Back:
human rights 10 years after the coup . Seule la version anglaise fait foi.
La version française a été traduite et diffusée
aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS
FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - septembre
2001.
Vous trouverez les documents en français sur LotusNotes, rubrique ÉFAI – IS
documents.
Vous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI : www.efai.org